Passons à la couleur

Sean O'Toole explores the role of colour in photography.
Il est très connu pour les portraits noir et blanc qu'il fait de femmes nigérianes sportives aux coiffures sculpturales élaborées, pourtant,J.D. ‘Okhai Ojeikere – appelé aussi "Pa" Ojeikere par ses nombreux admirateurs au Lagos – a également produit des photographies en couleur. En 1966, alors qu'il travaillait pour West Africa Publicity Ltd., une agence de marketing spécialisée, issue d'une entreprise coloniale qui proposait des services de publicité, Ojeikere a commencé son premier job chez Lintas, le département de publicité interne de Lever Brothers, l'entreprise britannique qui se cache derrière le savon Lux.
« L'entreprise a fait venir la première Miss Nigeria pour que je la prenne en photo », se souvenait Ojeikere, âgé de 83 ans, lors d'une interview publiée l'année passée, quelques mois avant sa mort en février. Comme c'était déjà le cas dans le monde de la publicité, Ojeikere, qui tout commeSantu Mofokeng, a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'assistant de laboratoire, a utilisé des films couleur pour faire ces photos. A l'époque, les photos en couleur étaient encore une nouveauté coûteuse au Nigéria.

</a> J.D.’ Okhai Ojeikere. Courtesy: Gallery Fifty One, Antwerp</figure>
Et Ojeikere d'ajouter : « Après avoir pris des photos de manière traditionnelle, ce qui constituait un de mes plus grands défis à l'époque, j'ai donné le film à mon chef pour qu'il le fasse développer à l'étranger car il n'y avait pas de laboratoire de photo couleur dans le pays à ce moment-là. »
Quand les photos de Miss Nigeria sont arrivées de Londres, l'enveloppe contenait une note avec cette remarque : « Soit mauvais éclairage ou le film a été utilisé pour faire des photos. » Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un problème d'éclairage. Ojeikere, dont l'héritage en qualité de photographe reposera toujours sur ses études monochromes de la culture et de l'inventivité nigérianes, dut rapidement se mettre à potasser la technique de la couleur. Miss Nigeria fut dûment invitée à revenir dans son studio.
« J'ai fait un autre job qui s'est avéré être de qualité. Par la suite, je suis devenu le conseiller d'autres photographes », déclarait Ojeikere. Il n'était pas le seul photographe africain à lutter – si pas au niveau de la technique, du moins au niveau de l’attitude – avec la photographie en couleur.David Goldblatt, le photographe humaniste au regard austère de Johannesburg, a résisté à l’usage de cette technique dans ses travaux pendant tout aussi longtemps alors qu'il la maîtrisait depuis déjà un moment.
« J'ai trouvé du plaisir à travailler avec des couleurs mais cela reste encore un peu trop coloré à mes yeux », m'avait-il déclaré lors d'une rencontre chez lui en 2002. « Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas persisté dans la couleur était liée au fait que c'était trop doux, trop coloré. » En guise de compromis, il s'est mis – ou du moins son technicien photographique Tony Meintjes – à délaver la couleur des nouvelles photos couleur de Goldblatt.
Une nouvelle génération de photographes africains (y comprisThabiso Sekgala etSydelle Willow Smith d'Afrique du Sud,Lakin Ogunbanwo du Nigeria etFilipe Branquinho du Mozambique) est moins influencée par une tradition dans laquelle la couleur représentait le langage du commerce, du moins aux yeux des photographes, alors que le travail sérieux de photographie, à savoir la photo motivée par une recherche personnelle, relevait du domaine du noir et blanc, en particulier en Afrique du Sud.

Thabiso Sekgala, Traces, Jabal Webdin, 2013. Courtesy: Goodman Gallery Lorsqu'il étudiait à la Michaelis School of Fine Art du Cap, Zwelethu Mthethwa, aujourd'hui portraitiste accompli, travaillait aussi en noir et blanc. Des exemples de ses premières oeuvres – des photos de carrefours, d'un township en dehors de la ville du Cap – ont été exposées lors de l'exposition d'Okwui Enwezor et de Rory Bester,Rise and Fall of Apartheid (Montée et chute de l'apartheid) – une vitrine encyclopédique de la tradition sud-africaine principalement en noir et blanc du photojournalisme et des documentaires photos. Mthethwa, accusé d'avoir mortellement blessé Nokuphila Kumalo, une prostituée de 23 ans, a été un grand détracteur de cette tradition dès la fin des années 1990, époque où ses photos couleur attiraient déjà l'attention du public international. Ses critiques, initialement émises dans une interview publiée pour le catalogue de l'exposition Democracy’s Images (1998, Umea, Suède), doivent beaucoup à ses études postuniversitaires aux Etats-Unis. Grâce à l'obtention d'une bourse Fulbright, Mthethwa a pu s'inscrire en maîtrise au RIT, le Rochester Institute of Technology à New York, en 1987. « Quand j'étudiais à Michaelis, ils n'avaient pas de matériel pour la couleur », m'avait expliqué Mthethwa en 2004. « Au RIT, nous disposions de 22 laboratoires couleur. » Ses premières expériences avec la couleur lui ont permis d'avoir un apercu de l’intérieur. « Quand j'ai observé les photos que j'avais prises avant d'aller aux Etats-Unis, un travail que j'avais déjà commencé en 1984, j'ai été choqué. » Et il ajoute : « Mon oeuvre semblait perpétuer le mythe selon lequel les gens pauvres sont misérables et vivent dans la rue. » Le passage décisif de Mthethwa à la couleur est devenu une façon de théoriser l'esthétique dans une Afrique du Sud postapartheid. La couleur ennoblit, pense-t-on. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette logique. « Je trouvais que mon travail et celui de gauchistes, de groupes, des archives et d'autres activistes et organisations ainsi que les efforts qu'ils avaient fournis étaient bafoués et rejetés au même titre que tout l'attirail qui accompagnait l'apartheid », écrivitSantu Mofokeng dans une interview par courrier électronique réalisée l'année passée. Mofokeng, dont certaines photos sont actuellement visibles à laBiennale d'art contemporain de Berlin, avait interprété les déclarations de Mthethwa comme une attaque opportune contre une tradition particulière de photographie en noir et blanc. « Je trouvais que nos efforts dans la lutte et la campagne en faveur du démantèlement et de l'abandon de l'apartheid étaient dénigrés », disait-il. « Il a surgi par hasard quand l'Afrique du Sud avait besoin d'un visage pour accompagner les développements du pays. Il a été consacré par d'anciens directeurs de musées de l’apartheid qui cherchaient à légitimer leurs collections et autres politiques qui avaient ignoré les images de lutte et les documentaires. » D'après un historien de l’art, John Peffer, auteur de l'ouvrage Art and the End of Apartheid (2009), la théorie sur la couleur de Mthethwa manque de précision du point de vue historique. De nombreux photographes associés à Afrapix, le collectif de photographes non-racial, anti-apartheid fondé parPaul Weinberg et Omar Badsha et dont faisaient partie, entre autres, Mofokeng etGuy Tillim, faisaient déjà des photos en couleur, argumente-t-il. Mais pour le citer : « Ils n'en faisaient pas grand cas. » Dans une certaine mesure, l'argument relatif aux couleurs – en particulier sur le plan de l'utilisation et de l'éthique de ce medium dans le cadre d’un travail sérieux au sein de l'Afrique du Sud postapartheid – est nourri et entretenu par une génération de photographes (et d’intellectuels) ayant toujours baigné dans la photographie analogique. « Avec l'avènement de l'ère du numérique, la couleur a gagné en suprématie », écrit Akinbiyi avec une once de résignation. « Le noir et blanc est généralement considéré comme un retour à une tradition jadis ancrée mais qui a plus ou moins perdu son public. » Ojeikere l'a également reconnu. « Nous sommes à l'époque du jet », avait-il déclaré l'année passée.

</a> Detail from ‘Found not taken’ series, March, 2013, Luanda, Angola. © E.Chagas</figure>
Cette expression reflète bien la situation, en particulier quand on considère le succès remarquable des documentalistes couleur tels quePieter Hugo etMikhael Subotzky d'Afrique du Sud ouEdson Chagas, le photographe angolais qui a remporté pour son pays le prestigieuxprix du Lion d'or pour le meilleur pavillon national lors de la Biennale de Venise de l'année passée.

</a> © Mikhael Subotzky and Patrick Waterhouse, Ponte City (detail)</figure>
En utilisant couramment le medium de la couleur, leurs œuvres – ainsi que celles de l'EgyptienNabil Boutros, du ZimbabwéenCalvin Dondo et deSammy Baloji, résidant à Lubumbashi – ont rapidement concrétisé une tradition fragile basée sur diverses pratiques. Leur œuvre est régulièrement raillée (ou rejetée) par une génération de photographes encore plus jeunes qui travaillent en couleur.

Après des études en architecture,Filipe Branquinho, originaire de Maputo, a grandi avec les photos en noir et blanc de Ricardo Rangel et de Kok Nam, d'éminents documentalistes du Mozambique qui ont consigné de nombreuses joies et souffrances liées à la naissance difficile de leur pays. Dans son étude du portrait en cours, Occupations (2011-), Branquinho reprend cependant une approche plus formelle que ses prédécesseurs. Il ne s'intéresse pas seulement au travail que font les gens à Maputo mais aussi au lieu où ils travaillent ; ses portraits en couleurs révèlent que la capitale du Mozambique au milieu de l'océan indien est un lieu de travail et d'entreprise, de fonctionnaires et d'athlètes mais aussi de pêcheurs et de marchands ambulants. Hugo est une référence, même si Branquinho fait preuve de plus d'empathie envers ses sujets que son homologue sud-africain, et qu'il est en fait plus proche par l'esprit du grand-père, le photographe allemand August Sander, des enquêtes occupationnelles. Lors de sa première exposition dans la confidence,Soft Walls, récemment visible à Johannesbourg et au Cap, Sydelle Willow Smith a formé son objectif en se concentrant sur l’expérience des immigrés, sur le processus difficile qu’est celui de se créer un chez soi et de trouver un travail dans un pays hostile aux migrants africains. La plupart de ses photos couleur ont été prises dans des maisons en Afrique du Sud, même si Smith prend tout aussi souvent le bus et le train avec les sujets de ses photos, au même titre que Goldblatt et Mofokeng le faisaient dans les années 1980. La décennie Willow était lancée. Occasionnellement, elle immortalise les détritus de la vie citadine : un amas de débris de verre d’une vitre de voiture, un graffiti de vagabond sur un viaduc. Smith a réalisé son travail dans le cadre du mentorat de photographie, Gisèle Wulfsohn Mentorship, un nouveau prix supervisé par l’atelierMarket Photo Workshop à Johannesbourg. Conçu en 1989 par Goldblatt comme un forum pour rendre la photo accessible à une plus grande partie de la population que ce n’était le cas à l’époque de la culture blanche sous l’apartheid, ce centre de formation, entre-temps institutionnalisé, compte parmi ses anciens diplômésZanele Muholi,Jodi Bieber etNontsikelelo Veleko. Aux côtés de Smith, d’autres jeunes diplômés dont les œuvres suscitent un intérêt incluentMack Magagane,Musa Nxumalo etThabiso Sekgala. « Etre un Africain joue certainement un rôle clé dans la perception teintée d’une certaine ironie de Sekgala », écritNjami au sujet de ce photographe né à Soweto. Peut-être. Après avoir vuRunning, une première exposition qu’il a assumée avec assurance à la Goodman Gallery du Cap, j’ai reconnu en lui un photographe éditorial compétent et un documentaliste idiosyncratique dont les photos parfois obliques suggèrent que Sekgala pourrait être le successeur apparent de la fragile tradition mentionnée plus tôt.

Thabiso Sekgala, Church, Jabal Webdin, Amman, 2013. Courtesy: Goodman Gallery. Au début, Sekgala a suscité l’intérêt du public en montrant la vie actuelle des anciens Bantoustans d’Afrique du Sud, ces Etats noirs indépendants dans la forme qui soutenaient la mascarade d’un développement distinct à l’époque de l’apartheid. En mélangeant des photos de paysages et des portraits de jeunes sujets, tous fondamentalement en couleurs, ses photos constituaient la parenthèse finale de Rise and Fall of Apartheid. Les dernières oeuvres en couleur de Sekgala présentent la vie de rue et la culture des cafés à Amman, Bulawayo et à Berlin. Sekgala est attiré par les coins de rue hors du commun. Ses photographies montrent un grand nombre de voitures garées et de chaises vides. Gokitima KgoPhala kekgo sepela, Bulawayo, une oeuvre datant de 2013, présente un piéton en costume qui se retourne vers le photographe en passant à côté de 6 mannequins nus et accentue la prouesse d’observation et le flou propres à Sekgala. Autrefois, il n’y a pas si longtemps que cela, les photographes étaient généralement convaincus que ce genre de travail n’était pas réalisable en couleur. Pour être honnête, la technologie mise à leur disposition ne les aidait pas. Le travail en couleur avait un effet édulcorant ; la qualité de l’impression n’était pas fiable. Lors d’une interview en 2006, Ojeikere remarquait qu’il avait “toujours préféré” la photo en noir et blanc. Pourquoi ? Les résultats duraient plus longtemps. « Les photos en couleur palissent rapidement en raison des colorants qu’elles contiennent. » Mais cela, c’était le cas à l’époque. L’âge du jet est bien arrivé et avec lui, toute une génération profite de ce que Tom Wolfe a un jour qualifié de « right stuff », des bons ingrédients. . Just Ask!, publié par Simon Njami, paraîtra à l’occasion du salonJoburg Art Fair au mois d’août. Rise and Fall of Apartheid Grandeur et décadence de l'apartheid est présentée au Musée de l'Afrique à Johannesburg jusqu'à la fin de Juin. . Sean O’Toole est écrivain et co-éditeur deCityScapes, une revue critique sur les enquêtes urbaines. Il vit au Cap en Afrique du Sud.
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
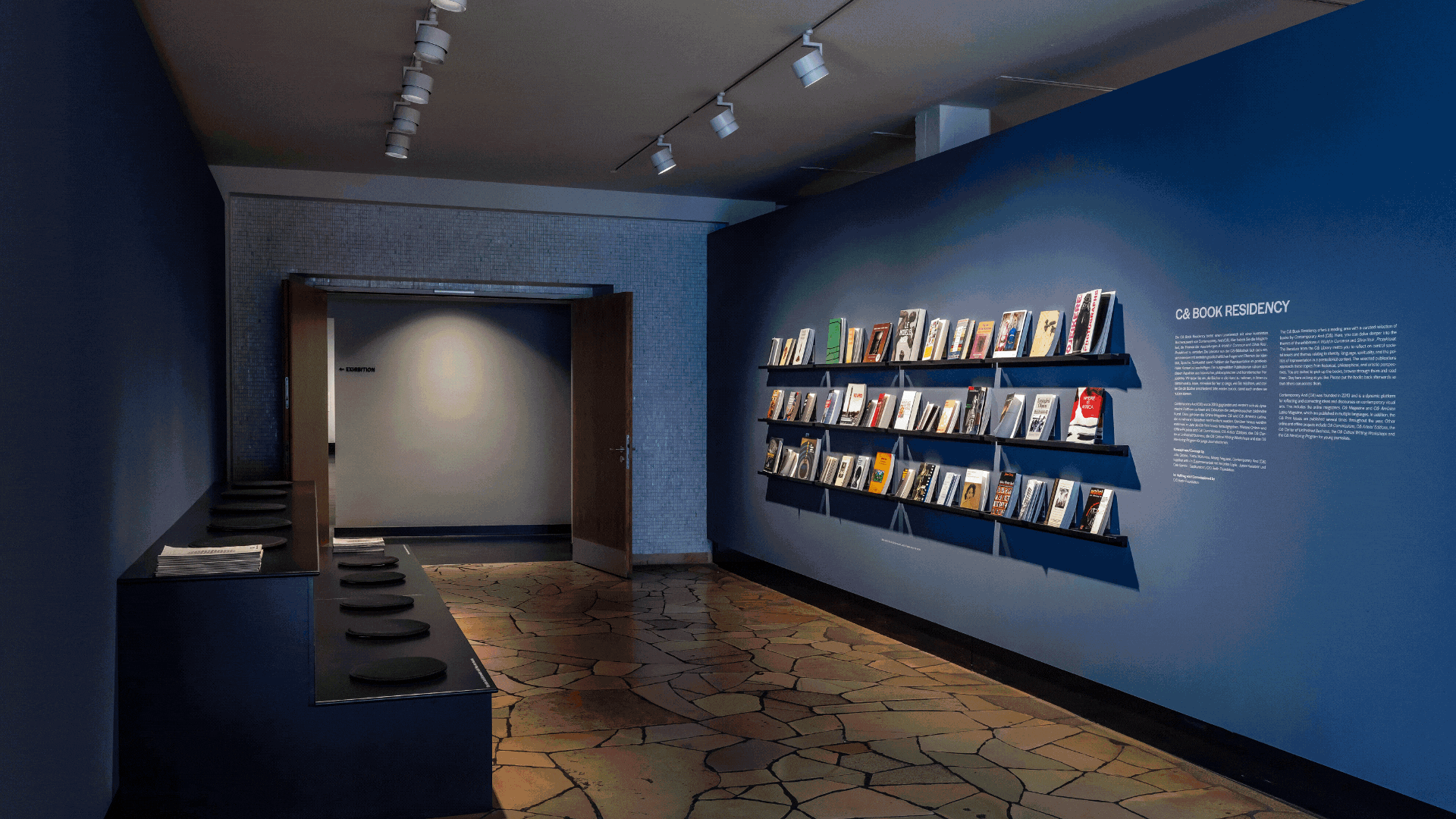
C& Highlights of 2025

Maktaba Room : annotations sur l’art, le design et les savoirs diasporiques
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
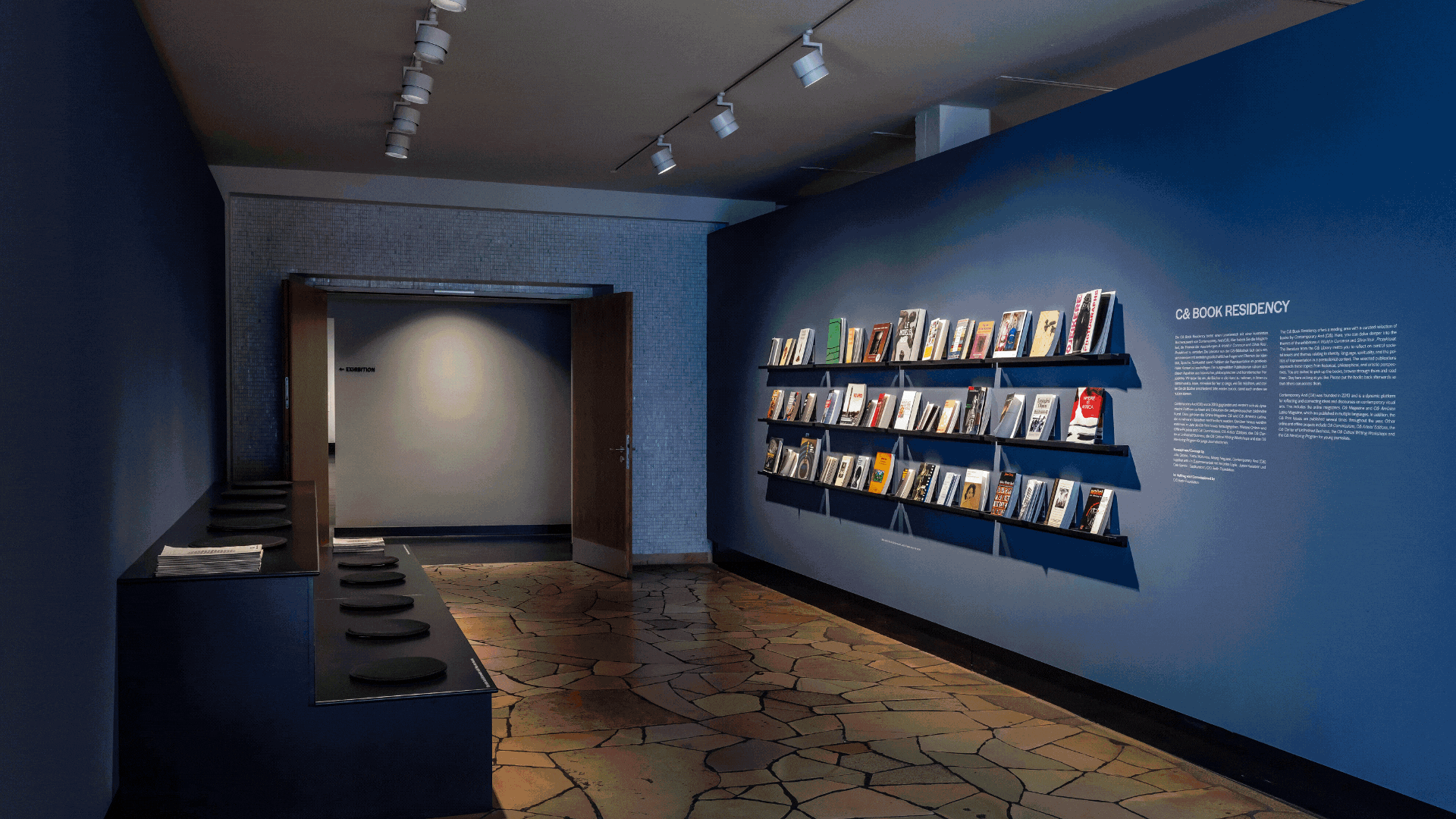
C& Highlights of 2025
