Through her fictional alter ego Marcue, Ugandan multimedia artist Immy Mali explores personal and postcolonial realities.
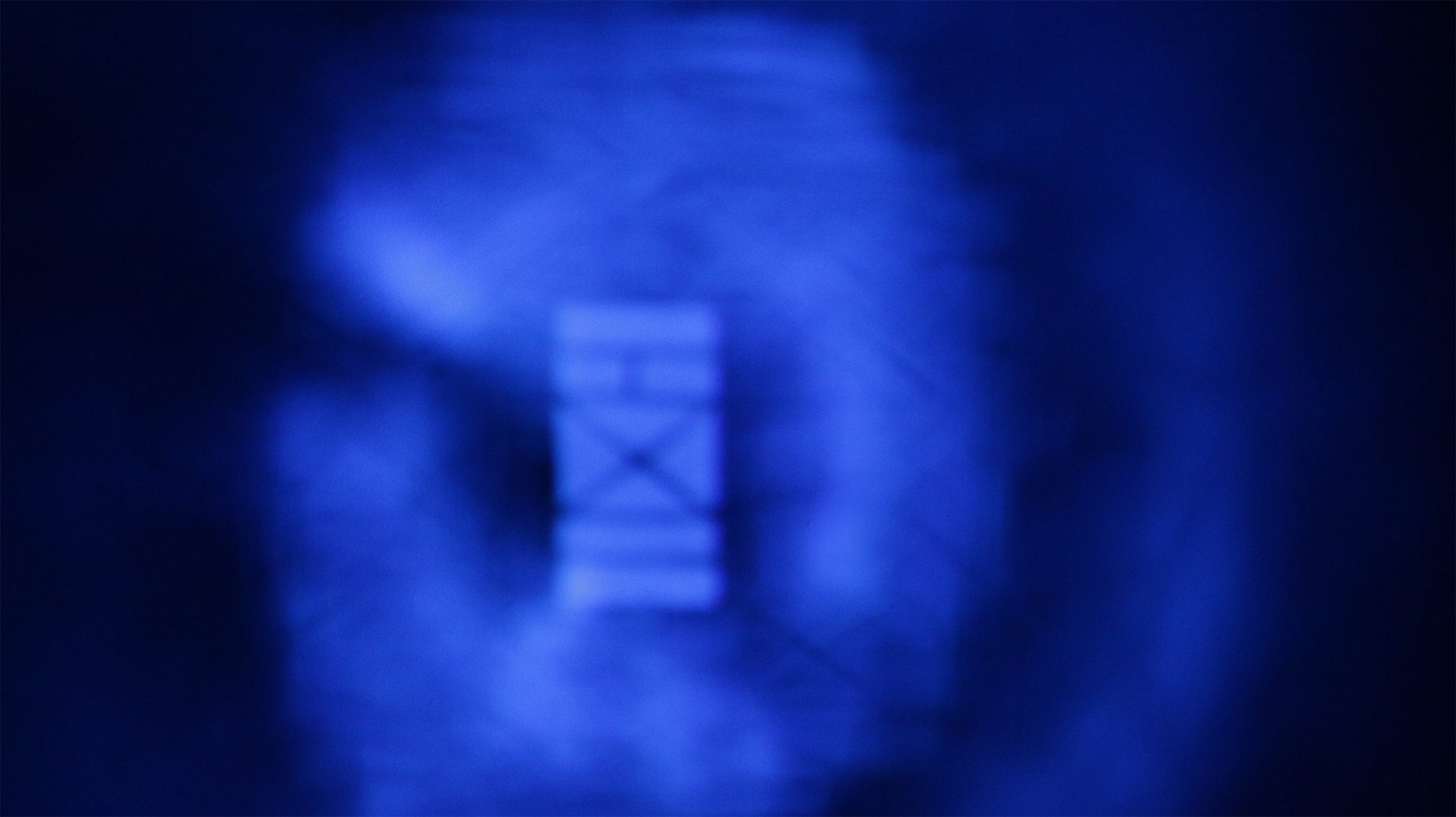
Immy Mali, Kasonko the portal, 2018. Digital edition. The dwelling place for all memory. In playing kasonko, we ascended in classes, we bought land and built houses, we became landlords and evicted neighbours.
Contemporary And : Vous avez écrit soixante-six lettres très intimes à une personne dénommée Marcue. Je trouve que c’est très courageux de les partager avec le public, merci ! Pouvez-vous nous raconter qui est Marcue et pourquoi vous avez commencé à lui écrire ?
Immy Mali : C’est moi qui vous remercie. J’ai commencé à écrire les lettres à un moment où je doutais de la direction à prendre avec mes installations et dans ma pratique en général. J’étais attirée par les thèmes de la mémoire et de l’enfance, et mon choix de matériaux reflétait la précarité : du métal rouillé, des cheveux, du verre brisé, des lames de rasoir. Un grand nombre de ces travaux avaient un lien avec les expériences de l’enfance, et dans une tentative de comprendre d’où venait cette imagerie morbide de l’enfance, j’ai commencé à écrire à mon moi plus jeune, Marcue. Mon espoir était que ce monologue, qui ressemble souvent à un dialogue, analyserait une enfance qui se reflétait dans des objets précaires.
C& : Dans votre première lettre, vous écrivez à Marcue : « J’espère que nous pourrons devenir de bonnes amies. » Cette phrase m’a beaucoup touchée parce qu’elle renvoie à un désir profond de faire la paix avec votre passé, presque comme une thérapie du traumatisme. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces processus ?
IM : En fait, je ne parlerais pas forcément de thérapie du traumatisme. Les lettres m’ont en tout cas permis de me regarder et de regarder les autres comme je ne l’avais jamais fait jusque-là. Elles ont pris forme alors que j’étais loin de l’Ouganda. Peut-être qu’elles étaient une manière de s’accrocher à un peu de son « chez-soi ». Lorsque je vois passer un chat, cela m’incite à demander à Marcue des nouvelles de Nancy, le chat de mon enfance qui s’est fait séduire par le gros chat de mes voisins. Lorsque j’entends La Lettre à Elise de Beethoven, cela me rappelle le marchand de glaces poussant sa glacière sur un vélo à travers les ruelles bondées de chez moi. Les objets du quotidien – ballons, tasses, tapis, sons – déclenchent des souvenirs et ainsi un désir d’écrire, de prolonger l’échange. Marcue est née d’une idée folle, mais lorsque cette folie a commencé à devenir sensée, elle a commencé à prendre forme. Lorsque j’écris à Marcue aujourd’hui, je la traite comme un être totalement indépendant qui renverra un jour des boîtes pleines de réponses à chaque lettre que je lui ai écrite.
C& : Il existe une tension entre toutes les questions que vous posez à Marcue et le fait que nous, lecteurs, n’ayons pas accès aux réponses. À travers les échos d’un passé mis sous silence, vous nous rappelez aussi les structures coloniales à l’aide de votre voix libérée et libératrice. Dans quelle mesure ces structures de pouvoir et de savoir jouent un rôle dans votre travail ?
IM : J’aime penser à mes installations, mes travaux sonores et mes dessins comme à des réponses de sa part. Bien évidemment, cela semble un peu bizarre que ce soit moi qui réalise ces œuvres d’art, mais c’est ma manière de le comprendre. Dans le processus d’écriture des lettres et lorsque je commence à disséquer les choses aussi simples que des comptines et des jeux d’enfants, je réalise qu’à un très jeune âge, l’éducation formate notre façon de penser. Les lettres révèlent lentement des vérités existantes, allant des dogmes religieux aux effacements de l’identité à travers un système d’éducation qui diabolise et punit les enfants lorsqu’ils parlent la langue locale. L’aller-retour entre Immy et Marcue nous emmène vers un lieu rempli de bagages actuels et historiques, que je ne sais pas toujours comment gérer.
C& : Ngūgī wa Thiong’o nous a rappelé l’importance de percevoir la langue comme la culture et de la valoriser en tant que mémoire collective, tandis que Moses Serubiri a parlé de rapatrier la langue. Dans certaines lettres, vous passez de l’anglais à votre langue maternelle, le lugbara.
IM : Dans une conversation que j’ai eue avec Moses il y a quelque temps, je lui ai dit que j’aurais aimé avoir un accent lugbara, car cela m’éviterait d’avoir à expliquer aux gens pourquoi mon anglais semble « bon », comme ils disent. La langue est véritablement un bastion de l’identité et de la culture de tout individu. Je parle quatre langues : le luganda, l’anglais, un peu de lusoga, et ce que ma famille dans ma ville natale d’Arua appelle le lugbara de Kampala. En essayant d’écrire et de réaliser des œuvres sonores dans ces langues, je profite d’un espace où réapprendre, désapprendre et exprimer ce qui ne peut pas être exprimé en anglais. Il existe des sons et des intonations qui sont simplement au-delà des limites de ce que l’anglais peut offrir. Avez-vous déjà pensé en une langue et dû exprimer vos pensées dans une autre ? C’est le genre de choses qui arrive souvent dans ce processus d’écriture.
C& : Dans votre vidéo By Shoe I Love You (2018), deux enfants jouent à un jeu avec leurs mains. Dans Because you play…we live (2020), des enfants animés jouent devant d’anciens tableaux. Qu’est-ce que représente l’aspect ludique dans vos œuvres et qu’est-ce qui vous fascine dans cet aspect ?
IM : Le jeu est un espace où les enfants prennent le contrôle, souvent hors d’un monde adulte. Lorsqu’ils vont jouer, c’est comme si les enfants allaient travailler. Cette idée est vitale pour moi dans mes tentatives d’entrer en contact avec Marcue. Certains des jeux imitent aussi le monde et les responsabilités adultes, tel que le jeu consistant à acheter et posséder des terres au Kasonko. Aussi, l’aire de jeux était un lieu dont il fallait souvent me protéger lorsque j’étais enfant pour que je ne me blesse pas à la jambe gauche, paralysée suite à un accident médical à l’âge de sept ans. Peut-être est-ce la nostalgie du jeu qui me renvoie sans cesse en arrière.
C& : Pour C&, vous avez créé des vidéos animées et des œuvres sonores. Dans Dreams in my head, nous entrevoyons l’album photo de l’enfance de Marcue. Comment les différentes couches de l’exposition en ligne communiquent entre elles ?
IM : Toutes les couches sont simplement Marcue, ses réponses aux lettres. L’album photo est une tentative de dresser son portrait à travers l’imagerie floue des souvenirs. Ces souvenirs sont souvent provoqués par des objets que Marcue a probablement utilisés et qui, de ce fait, servent de loupes pour les voir plus clairement. L’œuvre sonore et les animations sont toutes nées des lettres. L’exposition en ligne est ainsi le moyen de faire converger les divers médias du projet.
The multilayered experience of Letters to my Childhood is presented in six chapters in the frame of C& Commissions. Explore the art work here.
Immy Mali lives and works in Kampala. Her work revolves around notions of presence and absence, personal memories of childhood juxtaposed with current personal and collective narratives in Uganda and abroad. In Mali’s work, memory is a tool through which she describes the social (cultural and religious), political and economic landscape of Uganda not withholding post colonial and British imperial influences in the shaping of identities. Using a variety of media including, text, video, sound, sculpture, installation, animation, her work attempts to unpack the complexities and entanglements of memory and existence in a neo/postcolonial Uganda.
Interview by Theresa Sigmund.
More Editorial