De l'expérimentation à l'art vidéo dans le travail de FM Gustave Giresse

Il a recours à des images marquantes, telles que son propre visage recouvert d’une croûte de boue puis plongé dans un seau plein d’eau ou un robot faisant la circulation. Depuis que l’artiste congolais Fundi Mwamba (FM) Gustave Giresse a découvert le médium de l’art vidéo, le champ de ses explorations avec la caméra n’a plus connu de limites. Il ne craint pas de montrer des images choquantes de malformations physiques, comme dans son travail récent Ubatizo, la genèse du mal, ni d’aborder des sujets politiques comme l’exploitation de ressources naturelles. C& relate l’évolution de l’artiste, du dessin animé à la réalisation de vidéos.
À Lubumbashi, ville du Sud-Est de la République démocratique du Congo, il existe un savoir-faire artistique qui s’ignore ou, comme c’est souvent le cas, n’est pas apprécié à sa juste valeur. Le travail de Fundi Mwamba (FM) Gustave Giresse en est l’illustration assez éloquente. Passionné d’histoires à raconter, ce jeune artiste se lance dans la bande dessinée et bien d’autres médias encore, avant de s’essayer « de la manière la plus inattendue, à la vidéo, et par ricochet, à l’art vidéo[1] ». Comment, à partir d’une simple volonté de raconter des histoires au travers de personnages qui performent, arrive-t-on à atteindre des buts esthétiques communs à d’autres formes d’art contemporain ?
L’art vidéo en tant que « télévision faite par des artistes » est une discipline ayant la capacité de mobiliser les autres domaines du sensible, fusionner les arts en vue de rendre tangibles les utopies de l’art contemporain. Ainsi, le jeune artiste profite de ce savoir-faire pour interroger, établir des rapports, remettre en question, initier des dialogues entre son œuvre et le public qui la consomme. Avec dans chacune des vidéos un personnage qui performe, des textes quoique différents par les thèmes qu’ils abordent, dits ou mimés par le personnage, l’envie de montrer une curiosité, un savoir-faire, résultat d’une analyse réfléchie sur les structures propres à la vidéo, est présente. Ces histoires racontées ici sous forme d’une vidéo préalablement enregistrée, font remonter à la surface la critique des débuts de l’art vidéo par Nam June Paik (1960), de cette pratique artistique qui cherchait à savoir « si la technologie électronique révolutionnera la pratique de l’art contemporain ou si l’art “moderniste” ne fera qu’absorber la vidéo comme un support de plus, pour la réflexion esthétique ».
https://www.youtube.com/watch?v=Ztg-yWYz6fw
Par le protagoniste qui apparaît pieds nus et face masquée de boue, gesticulant entre quatre lampes allumées et un seau en plastique rempli d’eau, Chronique… (2016) ne serait-elle pas une démonstration de la flexibilité, de la malléabilité des arts contemporains, au point de les modeler sur d’autres formes, sans forcément dénaturer leur esthétique ? Suivant une chorégraphie synchrone avec le texte qu’il dit, le personnage mime, balbutie, bégaye les maux qui gangrènent un monde qu’il peint comme en « perte de vitesse, suite aux quantités de sang versées ». Un monde dans lequel les gens ont « le cerveau à l’endroit du cœur, le cœur à l’endroit du cul, le cul à l’endroit de la bouche et les couilles à l’endroit du cerveau ». Le cadrage met l’accent sur le texte dit, une action, des onomatopées et des bruitages. On sent le personnage recommander même de « se montrer têtu face au mal du monde qui, systématiquement, diminue tout le monde à l’état zéro ». Il trempe sa tête masquée dans l’eau que contient le seau en plastique pour d’abord se débarrasser du masque, qui tombe tel un sortilège et, ensuite, tendre vers son « illumination » ! De cette ablution, le protagoniste semble signer la fin d’un rite, d’un deuil duquel il sort aguerri, affirmant son existence au cri de « J’existe… ».
Cette mise en scène visiblement attachante marque les esprits et décomplexe le fond, face à la forme et le traitement que propose le réalisateur. Robot (2015), une vidéo sans son de 5 minutes 48 secondes, illustre à sa manière ce savoir-faire : elle met en scène un robot régulant la circulation tantôt seul, tantôt au coté d’un jeune homme s’exprimant en langage des sourds. Est-ce pour montrer une cacophonie qui existerait entre les deux manières de faire, celle d’une police de roulage humaine et celle qui serait constituée uniquement de machines ?

Fundi Mwamba (FM) Gustave Giresse, Robot (video still), 2015. Courtesy the artist. L’expérimentation du jeune réalisateur se veut sans limite en adaptant à la vidéo des scènes d’horreur. Ubatizo, la genèse du mal (2018) (ubatizo signifiant baptême en kiswahili) part d’une fiction inspirée de faits réels pour fustiger l’exploitation irresponsable et, loin d’être pragmatique, des richesses minières. Ici, FM se met lui-même en scène, dénonce l’exploitation désordonnée des minerais qui, selon lui, plonge le village Bofwa dans la « monstrification », pour parler des malformations congénitales ayant fait suite à ce qu’il appelle la « profanation de la rivière sacrée du village ». Les images des malformations montrées sont choquantes. Elles interpellent sur des pratiques qui détruisent la vie humaine. Et c’est un problème de taille dans un pays dit « scandale géologique » comme le sien. Quelle que soit l’idée de départ pour la réalisation de ce travail, on peut remarquer que de l’expérimentation des pratiques artistiques, des talents peuvent être révélés et orientés vers de nouvelles manières de raconter des histoires. Qu’ils se meuvent ou qu’ils soient figés, les plans de ce travail lui confèrent une profondeur, une dynamique, une énergie qui s’emballe en « chorégraphie » pour se fondre dans les décors, au travers des textes dits ou mimés. Témoin du pouvoir qu’ont les nouvelles technologies à révolutionner la pratique contemporaine de l’art.[1] Propos recueillis par moi-même lors d’un entretien accordé par l’artiste en personne le 22 mai 2018. Costa Tshinzam est un écrivain, bloggeur et auteur de la communauté Habari-RDC. Il a participé à l’atelier d’écriture critique C&, généreusement financé par la Fondation Ford, à Lubumbashi. Il vit et travaille à Lubumbashi en RDC.
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
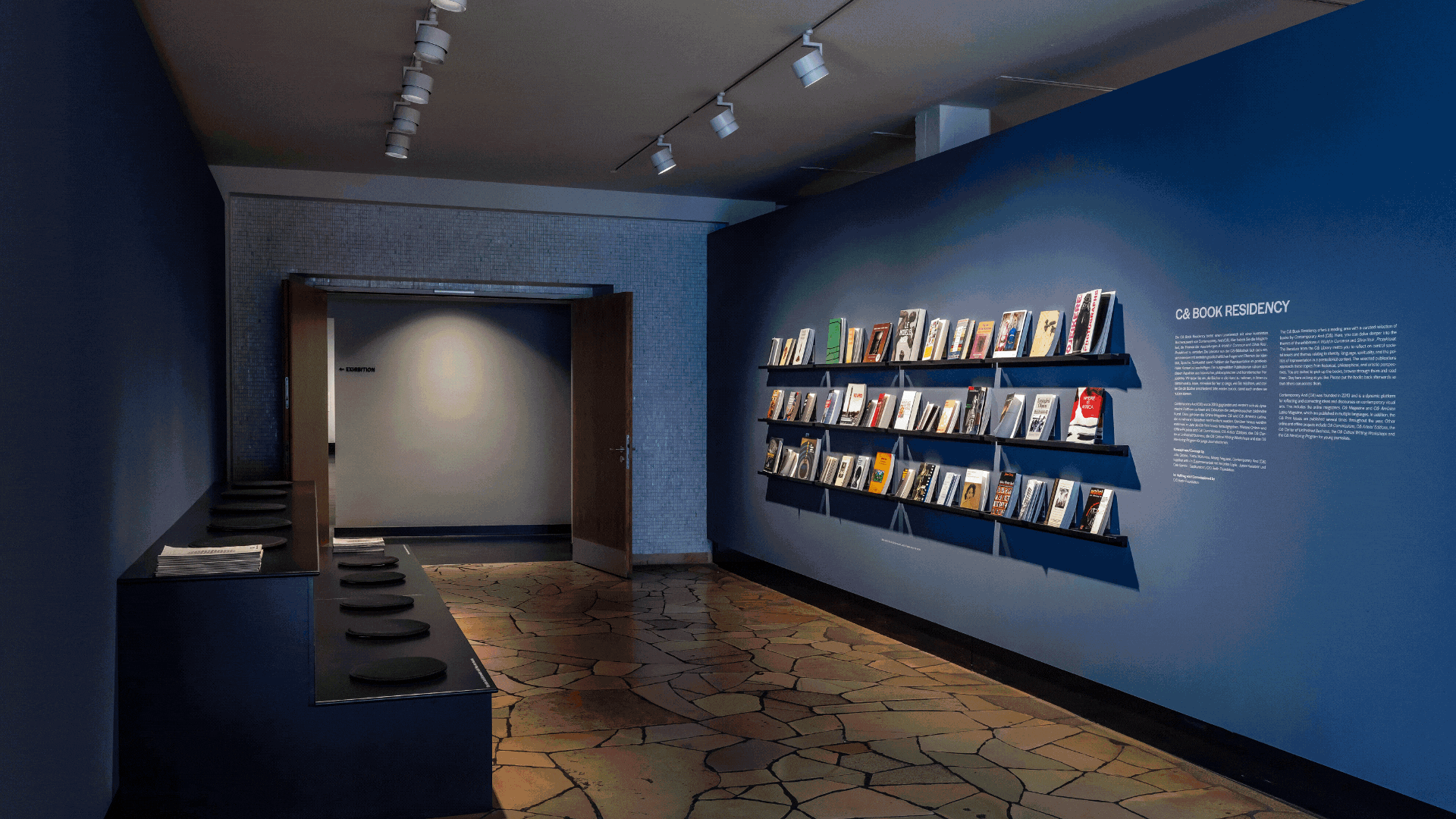
C& Highlights of 2025

Maktaba Room : annotations sur l’art, le design et les savoirs diasporiques
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
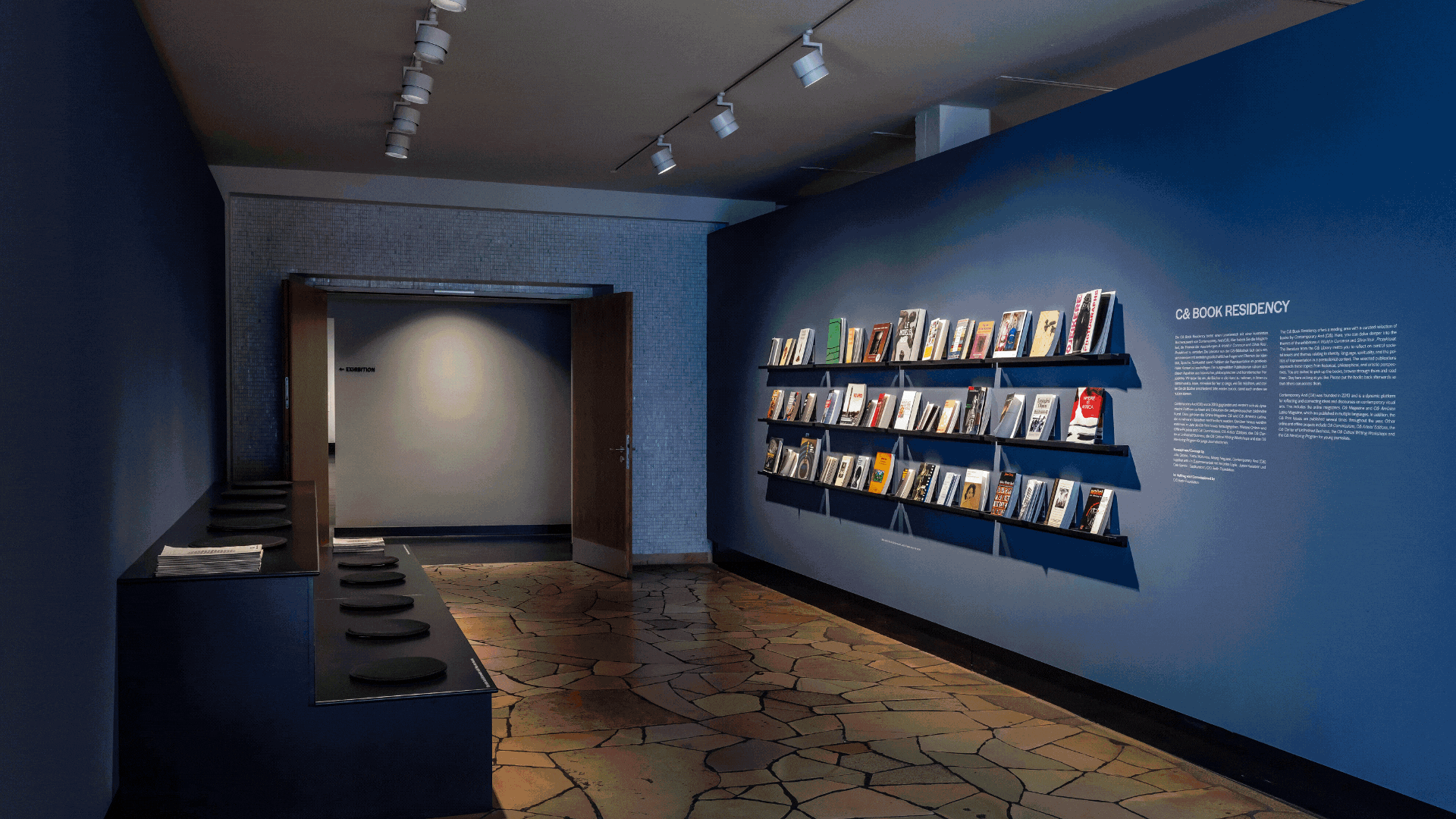
C& Highlights of 2025
