Cet article fait partie d’une série produite en collaboration avec le magazine Aperture, coïncidant avec le numéro d'été 2017 d’Aperture, «Platform Africa».

Samuel Fosso, La femme libérée américaine dans les années 70 (The liberated American woman of the 1970s), 1997, from the series Tati © the artist and courtesy JM Patras/Paris
Tout à commencé avec des talons hauts. En 1976, Samuel Fosso, adolescent précoce, voyage de Bangui en Centrafrique, où il est propriétaire d’un atelier de photographie qui s’appelle Studio Photo Gentil, pour rendre visite à sa famille au Nigeria. Il y trouve une paire de bottes à semelle compensée qui ressemble à celles que portait le musicien highlife nigérian Prince Nico Mbarga sur les pochettes de ses albums. La grand-mère de Fosso accepte de lui acheter les bottes et il parachève le look dès son retour à Bangui en faisant confectionner des pantalons à patte d’éléphant chez un tailleur local. « Je me suis mis ma nouvelle tenue et je suis sorti. J’ai rencontré un prêtre dans la rue qui m’a dit, ‘Vous avez l’air beau. Vous ressemblez à un astronaute. Vous voulez atteindre le ciel ?’ Et j’ai répondu, ‘Oui!’ »
Depuis plus de quarante ans, Fosso, tout comme Cindy Sherman, Iké Udé, ou Yasumasa Morimura, se focalise sur un seul sujet : lui-même. Dans les années 1970, après les séances de prise de vue avec ses clients, il finit les rouleaux de pellicule en mettant en scène des autoportraits imaginatifs où il porte des lunettes de soleil, des maillots de bain, et des looks qui auraient remis en cause la sensibilité conservatrice de Bangui à l’époque. En jouant avec les codes culturels du style et de la pose, Fosso évoque le pouvoir de la transformation personnelle. Ses premières images expérimentales sont restées privées jusqu’en 1994, où il est invité à participer à la première édition de la biennale de Bamako. Dès lors, Fosso fraye le chemin de son art de l’autoportrait dans de nouveaux domaines de la théâtralité en brouillant les constructions du genre.
Avant son exposition au National Portrait Gallery à Londres en juin 2017, Fosso a parlé avec Yves Chatap, conservateur basé à Paris, de la photographie de studio, des influences artistiques, et de la performance des rôles qui font une vie.
Yves Chatap : Votre première exposition remonte à la première biennale de Bamako en 1994. Pouvez-vous nous raconter cette expérience ?
Samuel Fosso : Pour la première édition de la biennale à Bamako en 1994, des émissaires avaient été envoyés un peu partout en Afrique afin de trouver des photographes. C’est le photographe français Bernard Descamps qui lors d’un passage à Bangui a découvert mon travail et a souhaité m’inviter à l’exposition. Lors de notre rencontre, nous étions déjà dans la photographie couleur mais Bernard Descamps a souhaité voir mes images en noir et blanc des années 1970 qu’il a ensuite soumises au jury. C’est ainsi que j’ai eu ma première exposition au palais de la culture de Bamako, inaugurée par M. Alpha Omar Konaré, alors président du Mali.
Pendant ce séjour, nous avons effectué des stages, mais c’est six mois plus tard que j’ai appris que j’avais reçu le premier prix, qui m’a été remis en septembre 1995 en France à Paris où je venais pour la première fois. C’est à cette occasion que j’ai été exposé la première fois à Paris et avec Martin Parr et Marie-Paule Nègre.
YC : Comment s’est passé ce premier séjour en Europe ?
SF : Cela a été l’occasion de rencontrer des photographes comme Cartier Bresson, qui m’a félicité et conseillé pour mon travail. Je ne le connaissais pas, mais cela m’a donné du courage pour la suite, tout comme les encouragements de Malick Sidibé et Seydou Keita, car j’ai compris que ma démarche était un atout à ne pas négliger.
YC : Aviez-vous connaissance d’autres photographes du continent ?
SF : Avant d’arriver à Bamako, je ne connaissais aucun autre photographe du continent comme Malick Sidibé ou Seydou Keïta, mais pourtant, eux semblaient avoir eu connaissance de mon travail parce que mes images étaient accrochées avant mon arrivée. Je dois avouer que je ne savais pas que je produisais des photographies artistiques. C’était une découverte pour moi. Cela a été une grande surprise de voir Malick Sidibé et Seydou Keïta venir me donner des conseils sur mon travail et m’encourager sur mon avenir en tant que photographe artiste, en m’expliquant que c’était rare de voir un photographe se photographier lui-même. Je les ai remerciés pour leurs conseils et encouragements et j’ai pu découvrir leurs travaux lors de leur exposition pendant l’exposition.
Tout ceci m’a ouvert les yeux et lors de mon retour à Bangui, j’ai continué car je me suis dit que si je ne produisais pas, on m’oublierait. Ces rencontres sont le déclencheur de ma carrière actuelle.
YC : Revenons-en au commencement. Comment avez-vous fait vos débuts dans la photographie ?
SF : Je suis né au Cameroun. J’ai été un enfant paralysé et ma mère avait honte de me faire filmer comme les autres bébés. J’ai été guéri à la suite des soins de mon grand-père dans l’Est du Nigeria, mais la guerre du Biafra est arrivée en 1967. C’est à cette période-là que mon oncle m’a ramené au Cameroun puis en Centrafrique, où nous avons travaillé comme fabricants de chaussures pour dames. Dans notre rue, il y avait un photographe de studio avec qui je passais parfois du temps et je lui ai demandé à apprendre la photographie. J’ai passé cinq mois d’apprentissage à la suite desquels j’ai voulu avoir mon propre studio. Mais le problème était de pouvoir faire des tirages sans perdre trop de papier, car comme disait mon oncle, « on ne fait pas de commerce pour perdre mais on fait le commerce pour gagner ». Mais j’ai su que le propriétaire ne souhaitait pas que je parte car il ne perdait plus d’argent depuis que je travaillais dans son studio. A la suite de cette découverte, mon oncle m’a demandé de chercher un local pour installer mon propre studio et il m’a acheté un agrandisseur.
YC : Vous évoquez votre enfance et votre maladie. N’est-ce pas une forme de thérapie contre ce corps en souffrance quand vous mettez en scène aujourd’hui ?
SF : Effectivement, parce que le mouvement du corps fait partie de la santé, par exemple si on se réfère aux sportifs. Pour mon corps, c’était les troubles par rapport à la maladie et la guérison, mais aussi les soins que mon grand-père a exercé sur moi—peut-être que j’ai dû souffrir de ça. Quand tu regardes mes travaux, c’est mon corps qui me regarde, c’est ma façon de voir, peut-être que c’est ma maladie, je ne sais pas, mais ce qui est important, c’est que c’est mon corps naturel.
YC : Voyez-vous votre grand-père comme un héros ?
SF : Pour moi, oui, mon grand-père est un héros parce que je ne suis pas le seul qu’il a eu à guérir. Toute sa vie, il a été un guérisseur qui soignait les fous. Quand on emmenait un fou et que mon grand-père arrivait, au bout de deux semaines, le fou commençait à répondre et à retrouver son état naturel et sa conscience normale et ensuite la famille pouvait venir le récupérer. A cette époque, l’argent était assez difficile à avoir et c’est par des centimes de shilling qu’on le payait. Ma famille n’arrivait pas vraiment à survivre. Je ne suis pas le seul que mon grand-père a guéri, il a guéri beaucoup de personnes. Tout le village le considérait comme un héros et c’était un notable auprès duquel le village prenait conseil sur les décisions importantes. Pour moi, c’est un héros et il le mérite.

Samuel Fosso, The Businessman, 1997, from the series Tati
© the artist and courtesy JM Patras/Paris.
YC : Pourquoi mettre en image cette histoire qui est de l’ordre de l’intime ?
SF : Simplement parce que les Occidentaux n’ont jamais cru aux médecines traditionnelles. Je suis le témoin de cette idée que le guérisseur peut soigner beaucoup de choses. C’est une forme d’éducation sur les pratiques de cette médecine traditionnelle qui a longtemps été rejetée.
YC : Quelle était la motivation de vos premiers autoportraits dans les années 1970 ?
SF : J’ai ouvert mon premier studio le 14 septembre 1975. J’ai commencé à me prendre en photo pour compenser le manque de photo que je n’avais pas eu pendant mon enfance. J’utilisais les fins de pellicules parce que je ne voulais pas les perdre. Lorsque je fermais le studio, je me filmais moi-même pour envoyer ces images à ma grand-mère au Nigeria. Je me faisais confectionner des habits sur mesure que je voyais dans des magazines plutôt afro-américaines.
YC : Dans vos premières images dans les années 60, on voit des inspirations dans le style vestimentaire. Avez-vous des icônes qui vous inspirent dans vos choix ?
SF : Si vous prenez l’exemple de Nico Mbarga—je me suis plutôt inspiré de lui, plus particulièrement pour ses vêtements. J’ai fait confectionner des habits et j’ai acheté des chaussures appelées talons dames qu’on ne trouvaient pas en Afrique centrale. Quant à Fela Kuti c’était politique car il y avait des dénonciations, nous n’étions pas toujours libres, et nous ne pouvions donc pas faire n’importe quoi. Dans les années 1977 à 1980, et surtout avant la démocratie, les conditions n’étaient pas faciles, notamment au sujet des dénonciations politiques. Cela me faisait un peu peur car je n’avais pas envie d’être arrêté.
YC : Vous aviez donc conscience que votre approche pouvait avoir un impact ou un enjeu politique ?
SF : J’étais conscient qu’il y avait un impact politique et par conséquent je ne pouvais pas faire n’importe quoi.
YC : Trois ans après votre participation à la biennale de Bamako, le grand magasin parisien Tati vous a engagé pour créer une série d’images. Tati (1997) comprend quelques unes des images les plus connues de votre carrière. Il s’agit d’archétypes et de personnages, de la vedette jusqu’à l’homme d’affaires et la femme bourgeoise. Dans cette série, quel était le discours que vous souhaitiez exprimer ?
SF : C’est un discours sur la ségrégation et l’esclavage et une revendication d’indépendance, de liberté. J’ai regroupé toutes ces idées qu’on peut voir dans cette image « La Femme américaine libérée » que j’ai faite lors d’un séjour aux États-Unis et dans cette même direction que va la série African spirits (2008). Dans cette dernière série, il y a volonté d’inscrire au musée tous ces personnages qui ont marqué l’histoire des Noirs en Afrique et en Amérique. Il faut avoir conscience qu’ils ont tous lutté pour les droits civiques et les libertés des Noirs et c’est un héritage que nous ne devons pas oublier. Je devais leur rendre hommage car ils ont permis que nous soyons d’une certaine manière libres et de les mettre dans l’histoire pour que nos enfants puissent se rappeler ce qui s’est passé hier et qui continue à se passer aujourd’hui.
YC : Vos séries Mémoire d’un ami (2000), qui traite d’un voisin tué lors d’un cambriolage à Bangui, et Le rêve de mon grand-père (2003), sur votre grand-père, sont des explorations très personnelles. Quand vous travaillez votre corps, vous le vivez comme corps sujet ou corps objet ?
SF : Quand je travaille, c’est toujours une performance que je choisis de faire. Ce n’est pas un sujet ou un objet, c’est plus un être humain. J’associe mon corps à ce personnage, puisque j’ai envie de traduire son histoire. Je considère mon corps comme un être humain mais appartenant toujours à d’autres sujets, à la personne que je suis en train de reproduire.
YC : Et techniquement, comment travaillez-vous dans le studio?
SF : À présent, je travaille avec une équipe constituée d’habilleurs, de maquilleurs, et d’un photographe assistant pour réaliser mes prises de vues. Auparavant, comme je le disais, je le faisais sans savoir que j’étais artiste. Je réalisais mes autoportraits moi-même en utilisant le système de retardateur de huit à dix secondes. Maintenant, je travaille donc avec plus de facilité qu’auparavant, car j’utilise un appareil photo avec télécommande, donc je peux voir si ma position correspond à l’image que je souhaite. C’est un avantage par rapport au passé car la technique est la même, mais la prise de vue est différente par rapport au travail.
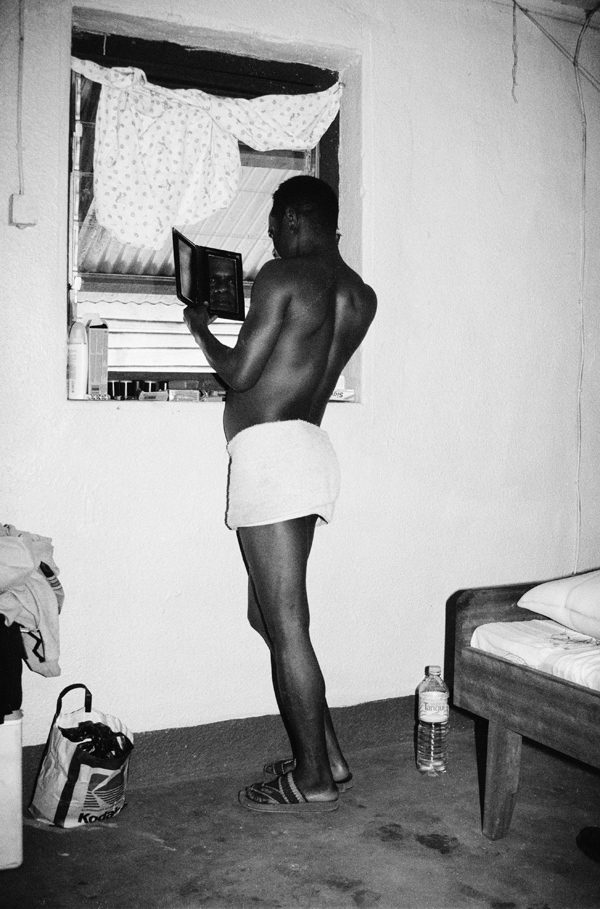 Samuel Fosso, Mémoire d’un ami (Memory of a friend), 2000 © the artist and courtesy JM Patras/Paris
Samuel Fosso, Mémoire d’un ami (Memory of a friend), 2000 © the artist and courtesy JM Patras/Paris
YC : Vous êtes revenu à Bamako en 2007 pour la rétrospective de votre travail. Quelles ont été vos impressions de cette expérience depuis la première biennale? Surtout, quel a été votre rapport avec les jeunes photographes qui vous voyais comme le grand maître ?
SF : En 2007, les choses avaient rapidement évoluées et cette rétrospective était importante car j’avais évolué depuis 1994. J’avais produit d’autres travaux dans la continuité des précédentes séries, donc ce retour en 2007 à Bamako pour une monographie était une fierté. J’ai rencontré beaucoup de photographes maliens qui avaient envie de me rencontrer et parler de la photographie. Ils m’appelaient « le grand maître. » Et il y avait mon film documentaire fait par la BBC en 2002. On avait discuté sur le sujet de la photographie et sur la manière dont je produisais mes images. Cette monographie qui a été présentée à Bamako a tourné pendant deux ans un peu partout dans le monde grâce au ministère de la Culture de France. Mes impressions sur les jeunes photographes était plutôt bonne puisqu’ils avaient compris l’importance de la photographie africaine. J’étais très impressionné par cela car j’ai compris que la photographie africaine ne mourrait pas.
YC : En 2013, vous avez créé la série L’Empereur d’Afrique, où vous vous produisez sous la figure de Mao. Les images se basent sur de célèbres peintures du leader chinois. Pourquoi avoir choisi de faire cette série ?
SF : Après l’esclavage par l’Occident, il y a eu la colonisation, puis ensuite l’indépendance politique qui n’est absolument pas économique et nous frappe toujours aujourd’hui. On se retrouve avec la Chine qui profite du manque de moyens mais qui ne finance pas suffisamment.
En Afrique, personne n’avait conscience que de ce que pouvait devenir la Chine sur le continent. Tous les pays africains ont été pris par la Chine. Je vois ce qu’ils ont fait de leur propre pays avec la production de charbon et la pollution. Ils sont venus ici avec un argument de 50/50 pour reconstruire l’Afrique, sous prétexte que l’Europe n’en a plus les moyens. Mais on constate maintenant qu’ils détruisent et pillent les ressources naturelles du continent pour son propre intérêt, l’Afrique n’ayant su développer ses propres moyens de produire localement. Mais si la Chine s’en allait, que deviendrait l’Afrique sans son argent ? C’est de là que vient le titre de l’empereur, au regard de l’histoire de ce pays qui n’a vécu que sous un système impérial.
YC : Quand vous parlez du rapport que l’Afrique peut avoir avec l’Asie, ne peut-on pas y voir une sorte de fatalité sur le devenir de l’Afrique, mais aussi de l’individu ?
SF : Cette série traduit le constat d’une forme de répétition de l’histoire autour des questions de l’autonomie et de l’exploitation des propres ressources locales. On ne peut pas accepter de mettre l’empire chinois en Afrique de crainte de reproduire le passé. Au sein des états africains, les rapports sont compliqués et les ententes difficiles, donc si nous mêmes n’arrivons pas à trouver une entente, rien ne pourra évoluer.
YC : Dans votre dernière série SIXSIXSIX (2015), le corps n’est plus travestie, on retrouve un artiste sans fards. Pourquoi choisir de vous orienter dans cette direction?
SF : Cette série regroupe au total 666 images dont chacune est unique. C’est un travail où matière photographique n’a rien à voir avec un tirage analogique. Le challenge était de faire 666 images différentes en autoportrait dans lesquelles on retrouve une expression corporelle différente.
Dans cette série il y a le malheur et le bonheur. J’ai été très inspiré par ces deux aspects. SIXSIXSIX font référence aux chiffres du malheur. Je parle par rapport à tout ce que j’ai rencontré dans ma vie jusqu’à aujourd’hui. Après ma maladie, ça a été la guerre du Biafra, des millions de personnes sont mortes et moi j’ai été heureusement sauvé. Je suis parti en Centrafrique où j’ai vécu la même chose pendant les derniers conflits de 2014 où j’aurais pu perdre la vie, donc 666 qui est un chiffre du malheur tout en étant un chiffre du bonheur. Par rapport à tout ce que j’ai subi, Dieu était avec moi et m’a sauvé.
YC : Dans SIXSIXSIX, peut-on penser que c’est l’artiste Samuel Fosso ou un autre que l’on voit sur ces images ?
SF : Ce n’est ni le corps qui sourit, ni le corps qui pleure mais ça représente la vie et tous ces malheurs qui nous frappent dans notre intérieur. Au final, il s’agit d’émotions enfouies que nous créons nous-mêmes et d’exorciser mes propres ressentis face à cette situation.
De 1976 à 2014, je n’ai jamais été tranquille dans ma vie face aux actes des hommes qui créent toujours des malheurs contre les enfants et les innocents.
Yves Chatap est un conservateur indépendant basé à Paris.
More Editorial