Examiner les traces dé/coloniales à travers les collections coloniales

Cette collaboration entre l'Académie des Traces et C& explore les traces de l'héritage colonial aujourd'hui à travers plusieurs textes de chercheur/euse/s émergentes et de professionnel/le/s des musées des continents africain et européen.
Les traces du colonialisme façonnent encore notre vie quotidienne et continuent à structurer notre manière de penser, de travailler, de vivre et d'aimer, ainsi que les privilèges dont nous bénéficions - ou dont nous sommes exclu/e/s. Examiner comment ces traces se manifestent dans les collections muséales et, plus largement, dans l'héritage colonial, a été au cœur des activités de l'Académie des Traces.
L'Académie des Traces est un réseau vivant offrant une plateforme de partage de méthodes, de savoirs et de perspectives sur l'héritage colonial. Elle s'appuie sur la collaboration à long terme entre un réseau de chercheur/euse/s et de professionnel/le/s des musées à l'intersection de l'histoire de l'art, de la philosophie, de l'anthropologie, des études patrimoniales et muséales, à travers les continents européen et africain.
En 2024, les membres de l'Académie des Traces ont développé une série de séminaires en ligne ainsi qu'une école de printemps s'appuyant sur l'ouvrage "Traces du dé/colonial au musée" (Éditions Horizons d'Attente, Paris, 2024). L'utilisation d'une barre oblique pour relier le colonial au dé/colonial marque pour nous un paradoxe récurrent au cœur de la discussion et des pratiques liées à l'engagement dans les collections formées pendant la période coloniale. Comme nous l'écrivons dans l'ouvrage :
"La recherche menée avec les collections risque constamment de retomber, souvent de manière imperceptible, inattendue et involontaire, dans la reproduction ou la réification des systèmes de pensée coloniaux, des asymétries de pouvoir, de l'essentialisme et du racisme auxquels on tente précisément d'échapper. (22-23)
C'est ce paradoxe qu'explorent les différentes contributions de cette collaboration entre C& et l'Académie des Traces. Le dossier réunit sept textes rédigés par les membres de l'Académie - des chercheur/euse/s , des commissaires d'exposition et des professionnel/le/s des musées émergent/e/s - ayant participé àl'école de printemps à Berlin en 2024.

Plusieurs contributions discutent et problématisent les processus de restitution et de retour d'artefacts culturels entre les continents européen et africain. En quoi la restitution a-t-elle un impact sur la politique étrangère et la diplomatie, et dans quelle mesure reflète-t-elle les continuités coloniales entre le Nord et le Sud ? Deux textes abordent cette question. La juriste Aliénor Brittmann retrace la construction et l'instrumentalisation de l'histoire pour l'établissement de relations contemporaines dans le cadre du processus de restitution d'un sabre entre le Sénégal et la France. L'historien de l'art Jan König et l'anthropologue culturel et social Elias Aguigah prennent la restitution très médiatisée des fameux bronzes du Bénin de plusieurs musées allemands à la République du Nigeria comme point de départ pour discuter de l'enchevêtrement des politiques économiques et culturelles dans la politique étrangère allemande. Trois contributions abordent différentes formes de retour et de restitution à la République du Bénin. L'historienne de l'art Salomé Soloum montre comment la République béninoise a intégré la restitution de 26 objets dahoméens du musée du quai Branly - Jacques Chirac au Bénin en octobre 2021 dans un plan de développement plus large incluant des objectifs touristiques et économiques. Dans le cadre de ce programme, une exposition itinérante internationale d'art contemporain béninois a été organisée. Adéwolé Faladé, doctorante en histoire comparée, s'appuie sur cette exposition pour discuter des implications des différentes formes et temporalités liées aux absences et aux présences de ces objets dans les musées français et béninois. Enfin, Carly Degbelo, prêtre catholique et gestionnaire du patrimoine culturel, s'intéresse au retour au Bénin de photographies d'archives issues d'une mission photographique et cinématographique menée en 1930 par le père Aupiais, rendue possible par le philanthrope Albert Kahn et accompagnée par le photographe et cinéaste Frédéric Gadmer. Il utilise des méthodes de recherche exploratoire afin d'approfondir la compréhension du matériel photographique en identifiant des parents vivants ou des connaissances des personnes représentées sur les images. Au-delà des questions de restitution, deux contributions abordent les contradictions dé/coloniales en discutant des politiques d'exposition et de santé en relation avec les collections coloniales. Dans son article, la conservatrice-restauratrice Ariane Théveniaud critique les présentations dites " open storage ", qui visent à offrir transparence et accès mais qui, selon son expérience professionnelle en réserves muséales, révèlent peu des pratiques réelles des musées. Elle démontre, au contraire, que ces présentations légitiment des idéologies de conservation occidentales tout en occultant les complexités de l'histoire des objets et des choix curatoriaux. En ouvrant le débat sur les collections historiques par le biais de l'art contemporain, la praticienne culturelle et chercheuse en santé Injonge Karangwa et l'artiste Anguezomo Nzé Mboulou Mba Bikoro explorent l'impact de ces collections sur les communautés africaines, en analysant comment les artefacts et leurs histoires influencent le bien-être des diasporas africaines comme celui des personnes vivant sur le continent. Le dossier paraîtra à l'occasion de l'édition 2025 de l'Académie des Traces, qui explore comment l'engagement avec l'héritage colonial peut contribuer à répondre à des défis sociétaux majeurs d'aujourd'hui. Tout au long du mois d'avril, les différentes contributions mentionnées ci-dessus seront publiées successivement. L'Académie organise parallèlementune série de séminaires en ligne consacrés à la médiation et à la participation (3 avril), au climat et à la durabilité (10 avril), à la numérisation et aux nouveaux médias (17 avril), et à la santé (mentale) (24 avril). Tous/tes les lecteur/ice/s de C& sont chaleureusement invité/e/s à y participer -les inscriptions à tous les séminaires sont désormais ouvertes ! Margareta von Oswald, rédactrice en chef de la collaboration entre C& x Académie des Traces LIRE TOUS LES ARTICLESICI. Les contributions de ce dossier ont été accompagnées et éditées par Margareta von Oswald en collaboration avec C& Magazine, et relues par Manyakhalé "Taata" Diawara. Ce texte a été traduit par Manyakhalé "Taata" Diawara de l’anglais. Margareta von Oswald est anthropologue ( PhD, EHESS/Humboldt-Universität zu Berlin) et travaille à l'interface entre recherche universitaire, collections et société. Elle est actuellement coordinatrice de recherche à inherit. heritage in transformation à la Humboldt-Universität zu Berlin, et chercheuse associée au Centre Marc Bloch, Berlin. Dans ses recherches et sa pratique curatoriale, elle s'intéresse aux processus de négociation autour des patrimoines sensibles et à la question de savoir comment les musées peuvent devenir des espaces véritablement démocratiques. Margareta von Oswald reconnaît le soutien du Centre for Advanced Study inherit. heritage in transformation, financé par le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) sous la référence de financement 01UK2402.
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
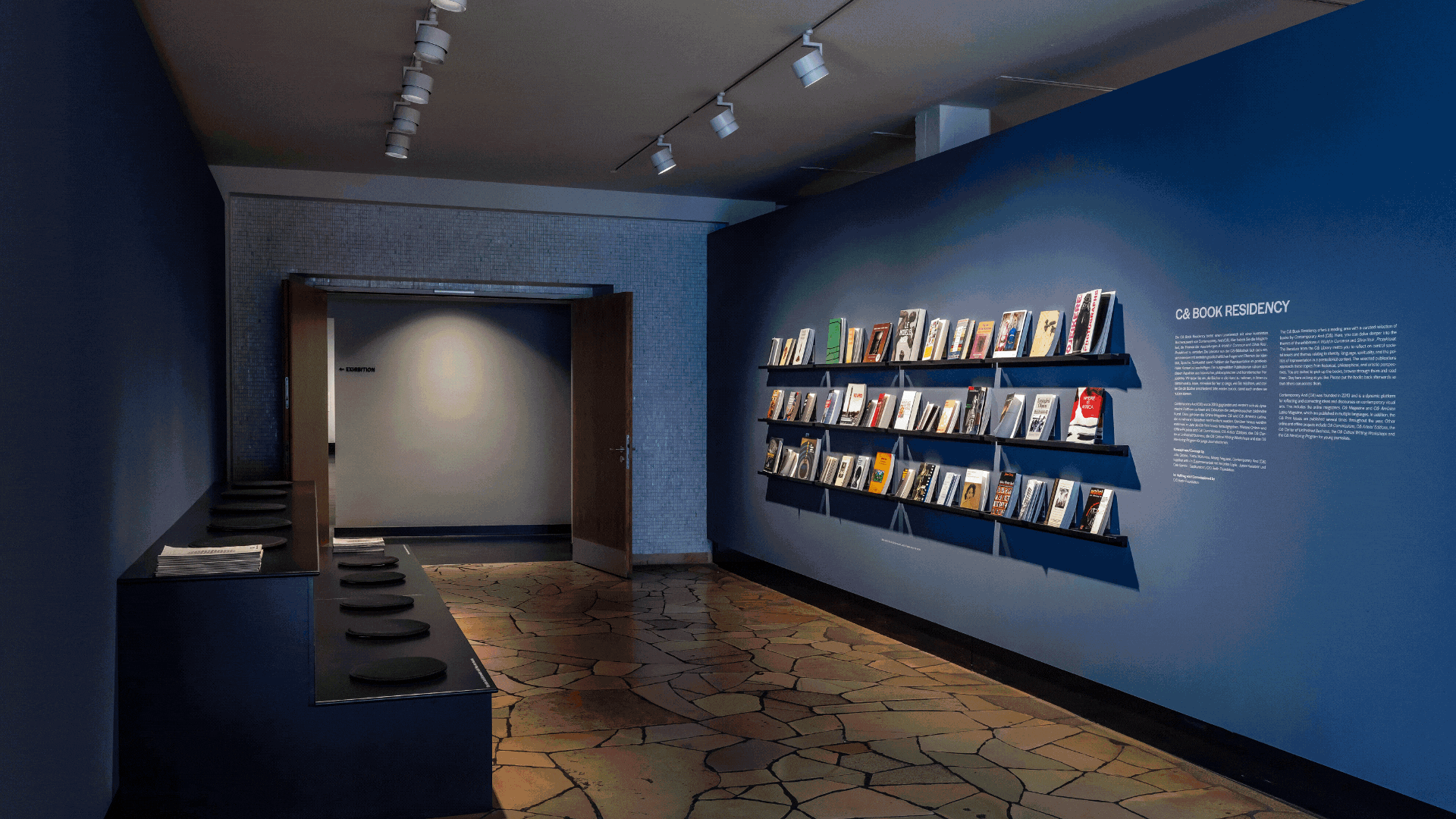
C& Highlights of 2025

Maktaba Room : annotations sur l’art, le design et les savoirs diasporiques
Fonction

We're Still Here: Thero Makepe’s Visual Jazz
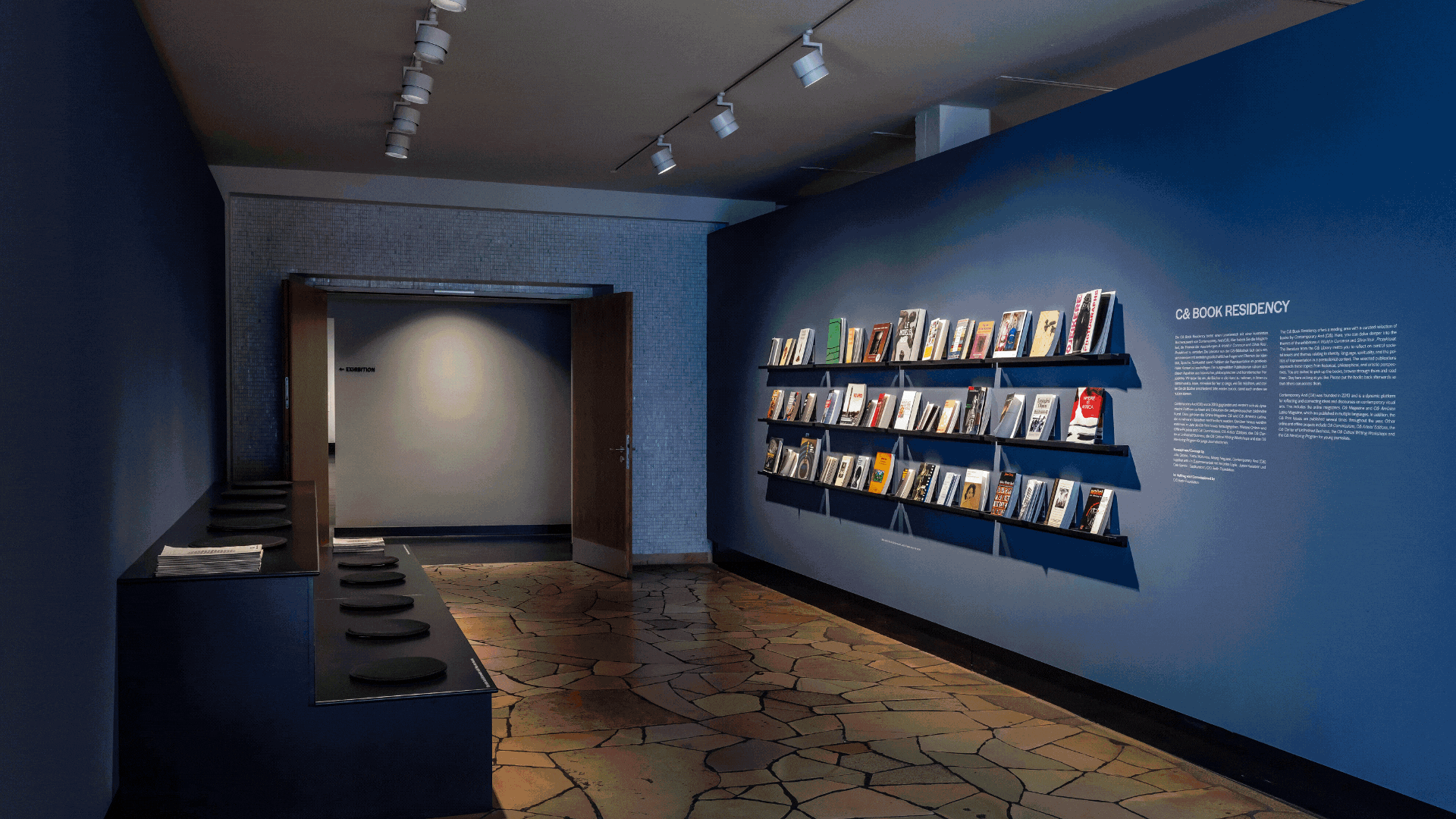
C& Highlights of 2025
