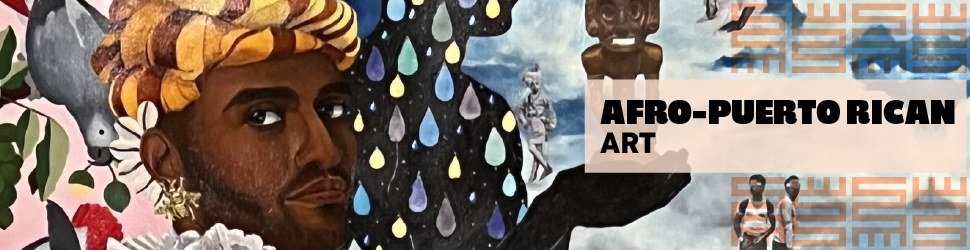La dignité sous contrainte : la peinture figurative panafricaine au-delà du marché de l’art international

Kwesi Botchway, Green Fluffy Coat, 2020. Acrylique sur toile, 78,7 × 78,7 cm / 31 × 31 in. Avec l’aimable autorisation de la Gallery 1957.
09 July 2025
Magazine C& Magazine
Words Elikem Logan
Translation Myriam Ochoa-Suel
5 min de lecture
Le marché international a adopté l’art originaire d’Afrique, mais cela suffit-il à le soutenir ? L’auteur Elikem Logan appelle à de se détourner de la confiance en l’altruisme des institutions occidentales et à se tourner vers une industrie de l’art au-delà des marchés.
En mars 2025, la galerie Wienerroither & Kohlbacher a dévoilé une peinture époustouflante de Gustav Klimt à la foire de l’art TEFAF, tout d’abord à Maastricht puis, un peu plus tard, à New York. Le tableau représente William Nii Nortey Dowuona, un chef du groupe ethnique Ga du Sud du Ghana moderne, qui avait été amené à Vienne en 1897pour être exposé dans un « zoo humain ». Rendu dans le style pictural délié de Klimt, le sujet a son épaule gauche drapée dans le vêtement de cérémonie encore porté par le peuple Ga aujourd’hui. Le portrait irradie une dignité à la fois sereine et résiliente, en dépit des circonstances déshumanisantes de la présence de Dowuona en Autriche.
Cette dépréciation du statut de souverain à celui d’objet d’exposition ethnographique met en lumière le paradoxe de la visibilité coloniale. La présence du sujet colonial dans le discours global n’est souvent rendue possible qu’en passant par le cadre interprétatif du colonisateur, un cadre qui permet la reconnaissance tout en limitant la signification. Ce tableau donne à voir la solennité de Nii Nortey Dowuona, mais c’est seulement à travers le regard de Klimt qui le transforme à la fois en sujet et en objet, un artefact façonné pour satisfaire la curiosité européenne. Sa dignité est limitée par un narratif qui nie son autonomie.
La sereine contradiction de ce portrait – cette dignité sous contrainte – reflète le défi éternel de l’art d’Afrique : pour être vu sur la scène mondiale, il semble devoir être façonné et souvent altéré par des systèmes externes de validation.
Le narratif défaitiste associé à la participation de l’Afrique au marché de l’art international est emblématique de ce phénomène contradictoire. J’ai récemment reçu un article publié par le magazine américain Vulture intitulé « How the Black Portraiture Boom Went Bust » (Comment l’ascension du portrait noir s’est disloquée). S’appuyant sur un petit échantillon d’artistes ghanéens, dont Kwesi Botchway et Serge Attukwei Clottey, l’article présente l’essor de l’art figuratif panafricain comme un effet secondaire de la prise de conscience raciale suite à l’assassinat de George Floyd en 2020. Les acheteurs désireux de purger leur conscience blanche auraient inondé le marché à la recherche dudit art noir pour mieux le déserter dès 2023 suite à une récession du marché international.
Sur le principe, les chiffres racontent une histoire similaire. Selon ArtTactic, un cabinet d’analyse du marché de l’art situé à Londres, les ventes aux enchères d’art moderne et contemporain d’Afrique ont chuté de 8 % en 2023 pour atteindre 79,8 millions de dollars américains, puis de nouveau de 45 % en 2024 à 43,9 millions de dollars. Mais sous la tête d’affiche, la réalité est complexe. Les ventes d’artistes africains du XXe siècle restent solides. Les foires d’art dédiées à l’Afrique et sa diaspora, comme la multi-sites 1-54 et l’Investec Cape Town Art Fair, publient des résultats équilibrés. En Afrique du Sud, Strauss & Co. a vu une augmentation de ses ventes. En phase avec les tendances plus générales du marché international, le volume général d’œuvres d’art vendu en 2024 a augmenté de 13 %, même si la valeur totale de ces œuvres a reculé.
Il y a des raisons de voir les acheteurs d’art d’Afrique simplement motivés par la culpabilité ou l’intérêt financier plutôt que par la passion. Botchway lui-même l’évoque dans l’article de Vulture : « Certains collectionneurs et collectionneuses ne voulaient même pas comprendre de quoi traitait l’artiste. » Mais ce point de vue fait abstraction de la majorité des collectionneur·euses africain·es qui continue à soutenir la croissance du marché. Nous n’assistons pas à la mort d’un mouvement mais à un détournement de l’attention des acheteur·euses de la tendance ultracontemporaine, peut-être vers des artistes sous-évalué·es qui ont une portée plus profonde au regard de l’histoire de l’art. Il y a eu quelques spéculations sur le marché, mais de là à décrire l’art figuratif panafricain comme le fugace bénéficiaire d’une tendance stimulée par BLM, c’est aussi désinvolte que restrictif.
En réalité, l’essor de l’art figuratif panafricain a été et reste un moment charnière, un de ceux qui ont donné une visibilité internationale à une génération d’artistes d’Afrique et de la diaspora comme ils l’entendaient. Il est bien plus facile de qualifier de tendance un phénomène que de réfléchir aux raisons de son succès, à ce qu’il représente et à ce que sa métamorphose en cours produira. Les forces qui définissent un mouvement d’histoire de l’art – innovation artistique, croissance institutionnelle et écho culturel – ne figurent que rarement dans les analyses de marché.
Le vrai problème ici n’est pas l’inconstance des marchés de l’art, mais bien la dépendance de l’Afrique de protections extérieures pour se comprendre elle-même. Il ne fait aucun doute que l’art noir ait besoin de recevoir un soutien essentiel hors d’Afrique, mais les institutions africaines doivent avoir la capacité de façonner de manière substantielle les narratifs qui nourrissent le succès international des artistes en Afrique et dans la diaspora. Lorsque les galeries, collectionneur·euses et média d’Occident détiennent le pouvoir unilatéral de sacrer puis d’abandonner des artistes, leurs legs deviennent vulnérables face aux caprices du goût, des modes et du symbolisme occidentaux.
Ce qui est désormais nécessaire, ce n’est pas un repli mais un rajustement. La voie à suivre consiste à mettre en place des systèmes de validation ancrés localement, engagés mondialement et autonomes. Cela implique de renforcer les liens entre artistes, commissaires, critiques, collectionneurs et collectionneuses et institutions à travers le continent. Cela signifie investir dans les archives, les expositions, les publications et l’éducation. Cela signifie forger un vocabulaire critique qui émerge de contextes africains, et pas juste en réaction à une attention externe.
Tout comme la dignité du chef Ga dépendait du regard plein de compassion de Klimt, la perception culturelle qu’a de soi l’Afrique compte toujours sur l’altruisme des institutions occidentales. La suspicion de contrebande autour de ce portrait affûte les contradictions morales de la circulation de la peinture figurative panafricaine – où les œuvres nées de l’exploitation sont blanchies comme œuvres d’art, leurs origines obscurcies au fur et à mesure que leur valeur augmente. Tel est le cycle que l’exposition historique de Koyo Kouoh au Zeitz MOCAA en 2022, When We See Us, avait essayé de déconstruire, en repensant la figuration panafricaine comme un acte d’autodéfinition long d’un siècle plutôt qu’une tendance dictée par le marché. Kouoh nous rappelle que le futur ne réside pas dans la seule visibilité, mais bien dans la puissance – les systèmes de droit d’auteurs africains, la responsabilité et le contrôle. Pour construire ce futur, nous devons achever ce que des sommités comme Bisi Silva, Okwui Enwezor et Koyo Kouoh ont commencé : un projet d’autodétermination culturelle.
À propos de l'auteur
Elikem Logan
Elikem Logan est un expert indépendant et historien de l’art qui se consacre principalement à l’art africain moderne et contemporain.
Plus d'articles de